
Essonne |
Paris |
Seine
et Marne |
Val
d'Oise |
Val
de Marne |
Yvelines |
Les
autres régions et autres châteaux |
- Les Autres régions
- Châteaux Renaissance
- Châteaux Classique
- Châteaux Cathares
- Châteaux d'Europe
Les sélections
des mois précédents |
| Autres rubriques
: - Histoire du château - Diaporama - Accueil château |
Château de Vincennes |
|
Dans son « Dictionnaire raisonné d’architecture médiévale », l’architecte français Eugène Viollet le Duc décrit avec un soin méticuleux l’incroyable forteresse de Vincennes. Nous laissons la parole à cet expert 1 - Les courtines et les tours de flanquement Sous Charles V on
modifia l'ancien dispositif défensif. On possédait
déjà de petites pièces d'artillerie, qui permettaient
d'allonger les fronts, d'éloigner les flanquements par conséquent.
On avait reconnu que les fronts courts avaient l'inconvénient,
si les deux flancs voisins avaient été détruits,
de défiler l'assaillant et de ne lui présenter qu'un
obstacle peu étendu, contre lequel il pouvait accumuler ses
moyens d'attaque. Aussi était-ce toujours contre ces courtines
étroites, entre deux tours, que les dernières opérations
d'un siège se concentraient, dès qu'au préalable
on était parvenu à ruiner les défenses supérieures
des tours par le feu, si elles se composaient de hourds, ou par
de gros projectiles, si les galeries des mâchicoulis étaient
revêtues d'un manteau de maçonnerie. Vers 1360, les
courtines furent donc allongées ; les tours furent plus espacées,
prirent une plus grande surface, eurent parfois des flancs droits,
- c'est-à-dire que ces tours furent bâties sur plan
rectangulaire,- et furent couronnées par des plates-formes.
Le château de Vincennes est une forteresse type conforme à
un nouveau dispositif. Le plan bien connu de cette place présente
un grand parallélogramme flanqué de quatre tours rectangulaires
aux angles, d'une tour (porte) également rectangulaire au
milieu de chacun des petits côtés, de trois tours carrées
sur l'un des grands côtés, et par le donjon avec son
enceinte sur l'autre.
Les tours d'angles
sont dotées de gros contreforts reposant sur un talus montant
jusqu'à la corniche supérieure, qui n'est qu'une suite
de larges mâchicoulis. Les trois étages étaient
voûtés, et sur la dernière voûte reposait
une plate-forme dallée, propre à recevoir, ou de grands
engins, ou des bouches à feu. Un crènelage protégeait
les arbalétriers. 2 - Considérations sur l’évolution des hauteurs de murailles Il est curieux de
suivre pas a pas, depuis l'Antiquité, ce mouvement d'oscillation
constant, qui, dans les travaux de défense, tantôt
fait donner aux tours ou flanquements un commandement sur les courtines,
tantôt réduit ce commandement et arasé le sommet
des tours au niveau des courtines. De nos jours encore (au XIXe
siècle donc) ces mêmes oscillations se font sentir
dans l'art de la fortification, et Vauban lui-même, vers la
fin de sa carrière, après avoir préconisé
les flanquements de niveau avec les courtines, était revenu
aux commandements élevés sur les bastions. C'est qu'en
effet, quelle que soit la portée des projectiles, ce n'est
la qu'une question relative, puisque les conditions de tir sont
égales pour l'assiégé comme pour l'assaillant.
Si l'on supprime les commandements élevés, on découvre
l'assaillant de moins loin, et on lui permet de commencer de plus
près ses travaux d'approche ; si l'on augmente ces commandements,
on donne une prise plus facile à l'artillerie de l'assiégeant.
Aussi voyons-nous, pendant le Moyen Age, et principalement depuis
l'adoption des bouches à feu, les systèmes se succéder
et flotter entre ces deux principes. D'ailleurs une difficulté
surgissait autrefois comme elle surgit aujourd'hui. |
|
Le château du mois |
Recherchez sur le site |
Pour toute question concernant ce site web, envoyez un message au webmaster

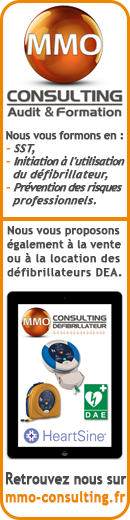


 Le tracé d'une place en projection horizontale peut être
rationnel, et ne plus l'être en raison des reliefs. Avec les
commandements élevés, on peut découvrir au
loin la campagne, mais on enfile les fossés et les escarpes
par un tir plongeant qui ne produit pas l'effet efficace du tir
rasant. Il faut donc réunir les deux conditions. Le château
de Vincennes fut donc, pour le temps où il fut élevé,
une tentative dont peut-être on n'a pas apprécié
toute l'importance. L'architecte constructeur des défenses
a prétendu soustraire les tours à l'effet du tir parabolique,
en leur donnant un relief considérable, et il a prétendu
utiliser ce commandement, inusité alors, pour le tir des
nouveaux engins à feu, et des grands engins perfectionnés,
tels que les mangonneaux et trébuchets.
Le tracé d'une place en projection horizontale peut être
rationnel, et ne plus l'être en raison des reliefs. Avec les
commandements élevés, on peut découvrir au
loin la campagne, mais on enfile les fossés et les escarpes
par un tir plongeant qui ne produit pas l'effet efficace du tir
rasant. Il faut donc réunir les deux conditions. Le château
de Vincennes fut donc, pour le temps où il fut élevé,
une tentative dont peut-être on n'a pas apprécié
toute l'importance. L'architecte constructeur des défenses
a prétendu soustraire les tours à l'effet du tir parabolique,
en leur donnant un relief considérable, et il a prétendu
utiliser ce commandement, inusité alors, pour le tir des
nouveaux engins à feu, et des grands engins perfectionnés,
tels que les mangonneaux et trébuchets. 
