|
Description des remparts
L'ensemble fortifié
constitue un rectangle approximatif d'un périmètre de 1,7 km, encadrant
une superficie de 16 hectares en terrain plat.
1 - La tour de
Constance
 Le
premier élément de cette enceinte fut la tour maîtresse, la tour
de Constance: elle occupe l'angle N. du quadrilatère, dans une position
fonctionnelle identique à celle de tours philippiennes comme Dourdan,
Nesles, ou encore Villeneuve sur Yonne. D'un diamètre moyen d'une
vingtaine de mètres, dotée d'un fort talutage, la tour était isolée
par un fossé propre ; son rez de chaussée voûté d'ogives possédait
un accès côté ville et un accès côté campagne, diamétralement opposés,
dotés de ponts-levis à treuil simple. La voûte de ce niveau est
ceinturée en hauteur par une gaine circulaire courant dans l'épaisseur
du mur : cette gaine avait pour objet de surveiller le rez de chaussée,
et de desservir assommoirs et herses défendant les deux entrées.
Comme le rez de chaussée, l'étage supérieur voûté d'ogives est garni
de longues archères à forte plongée qui attestent de la vocation
défensive de la tour. On ne peut cependant exclure que le programme
de celle-ci ait inclus dès l'origine la fonction carcérale, la gaine
de circulation intermédiaire en étant peut-être un indice. Au-dessus,
la terrasse possédait un parapet garni d'archères, épaissi au XVIe
siècle pour accueillir des créneaux à canon; la tourelle
d'un phare surmonte encore l'ensemble. Mais l'essentiel du rôle
de la tour était celui d'un symbole royal, à l'image des tours de
Philippe Auguste. La résidence des officiers royaux se trouvait
dans l'enceinte de la ville, sans fortification notoire. Le
premier élément de cette enceinte fut la tour maîtresse, la tour
de Constance: elle occupe l'angle N. du quadrilatère, dans une position
fonctionnelle identique à celle de tours philippiennes comme Dourdan,
Nesles, ou encore Villeneuve sur Yonne. D'un diamètre moyen d'une
vingtaine de mètres, dotée d'un fort talutage, la tour était isolée
par un fossé propre ; son rez de chaussée voûté d'ogives possédait
un accès côté ville et un accès côté campagne, diamétralement opposés,
dotés de ponts-levis à treuil simple. La voûte de ce niveau est
ceinturée en hauteur par une gaine circulaire courant dans l'épaisseur
du mur : cette gaine avait pour objet de surveiller le rez de chaussée,
et de desservir assommoirs et herses défendant les deux entrées.
Comme le rez de chaussée, l'étage supérieur voûté d'ogives est garni
de longues archères à forte plongée qui attestent de la vocation
défensive de la tour. On ne peut cependant exclure que le programme
de celle-ci ait inclus dès l'origine la fonction carcérale, la gaine
de circulation intermédiaire en étant peut-être un indice. Au-dessus,
la terrasse possédait un parapet garni d'archères, épaissi au XVIe
siècle pour accueillir des créneaux à canon; la tourelle
d'un phare surmonte encore l'ensemble. Mais l'essentiel du rôle
de la tour était celui d'un symbole royal, à l'image des tours de
Philippe Auguste. La résidence des officiers royaux se trouvait
dans l'enceinte de la ville, sans fortification notoire.
2 - L'enceinte
urbaine
 La
conception de l'enceinte d'Aigues Mortes a certainement été dictée
par une urbanisation préexistante; les neuf portes qui s'y ouvrent
sont suffisamment proches et irrégulièrement disposées pour que
l'on puisse affirmer qu'elles desservirent des rues en usage, au
point que les tours à but exclusif de flanquement sont au nombre
de cinq seulement ! La
conception de l'enceinte d'Aigues Mortes a certainement été dictée
par une urbanisation préexistante; les neuf portes qui s'y ouvrent
sont suffisamment proches et irrégulièrement disposées pour que
l'on puisse affirmer qu'elles desservirent des rues en usage, au
point que les tours à but exclusif de flanquement sont au nombre
de cinq seulement !
Dans les premières phases, celles du dernier quart du XIIIe siècle,
les ouvrages furent bâtis en appareil régulier à bossages rustiques,
parfaitement homogène avec les fortifications royales contemporaines;
l'achèvement de l'enceinte, à la fin du XIIIe et au début du XIVe
siècle, fut réalisé en pierres lisses. Les concepteurs distinguèrent
cinq portes principales, chacune constituée d'un passage entre deux
tours; quatre portes secondaires ménagées entre des contreforts
supportant des tours rectangulaires; enfin trois tours circulaires
et deux tours en U. Les portes principales constituent le fleuron
de cet ensemble; en effet, on trouve dans chacune d'entre elles
le concept à la pointe de l'innovation dans la fortification royale
du temps, celui des sas défensifs ménagés entre deux couples herse-assommoir
à l'intérieur du passage. Ces sas, surveillés depuis l'étage supérieur
par des assommoirs, permettaient en théorie d'intercepter les entrants
et de les identifier avant de les laisser entrer. L'autre caractéristique
majeure de l'enceinte d'Aigues Mortes réside dans la recherche qui
y fut menée en matière de conception des archères. On trouve, en
effet, au long des courtines de l'enceinte, des niches de tir plus
ou moins sophistiquées, depuis la niche classique à " coussiéges
" (sièges latéraux pour les servants), jusqu'à la niche à deux niveaux
séparés par un plancher de bois, desservant une fente d'archère
particulièrement longue.
Texte extrait du
livre de Jean Mesqui Chateaux
forts et fortifications
|


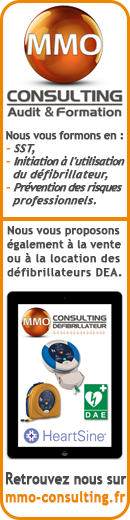
 Le
premier élément de cette enceinte fut la tour maîtresse, la tour
de Constance: elle occupe l'angle N. du quadrilatère, dans une position
fonctionnelle identique à celle de tours philippiennes comme Dourdan,
Nesles, ou encore Villeneuve sur Yonne. D'un diamètre moyen d'une
vingtaine de mètres, dotée d'un fort talutage, la tour était isolée
par un fossé propre ; son rez de chaussée voûté d'ogives possédait
un accès côté ville et un accès côté campagne, diamétralement opposés,
dotés de ponts-levis à treuil simple. La voûte de ce niveau est
ceinturée en hauteur par une gaine circulaire courant dans l'épaisseur
du mur : cette gaine avait pour objet de surveiller le rez de chaussée,
et de desservir assommoirs et herses défendant les deux entrées.
Comme le rez de chaussée, l'étage supérieur voûté d'ogives est garni
de longues archères à forte plongée qui attestent de la vocation
défensive de la tour. On ne peut cependant exclure que le programme
de celle-ci ait inclus dès l'origine la fonction carcérale, la gaine
de circulation intermédiaire en étant peut-être un indice. Au-dessus,
la terrasse possédait un parapet garni d'archères, épaissi au XVIe
siècle pour accueillir des créneaux à canon; la tourelle
d'un phare surmonte encore l'ensemble. Mais l'essentiel du rôle
de la tour était celui d'un symbole royal, à l'image des tours de
Philippe Auguste. La résidence des officiers royaux se trouvait
dans l'enceinte de la ville, sans fortification notoire.
Le
premier élément de cette enceinte fut la tour maîtresse, la tour
de Constance: elle occupe l'angle N. du quadrilatère, dans une position
fonctionnelle identique à celle de tours philippiennes comme Dourdan,
Nesles, ou encore Villeneuve sur Yonne. D'un diamètre moyen d'une
vingtaine de mètres, dotée d'un fort talutage, la tour était isolée
par un fossé propre ; son rez de chaussée voûté d'ogives possédait
un accès côté ville et un accès côté campagne, diamétralement opposés,
dotés de ponts-levis à treuil simple. La voûte de ce niveau est
ceinturée en hauteur par une gaine circulaire courant dans l'épaisseur
du mur : cette gaine avait pour objet de surveiller le rez de chaussée,
et de desservir assommoirs et herses défendant les deux entrées.
Comme le rez de chaussée, l'étage supérieur voûté d'ogives est garni
de longues archères à forte plongée qui attestent de la vocation
défensive de la tour. On ne peut cependant exclure que le programme
de celle-ci ait inclus dès l'origine la fonction carcérale, la gaine
de circulation intermédiaire en étant peut-être un indice. Au-dessus,
la terrasse possédait un parapet garni d'archères, épaissi au XVIe
siècle pour accueillir des créneaux à canon; la tourelle
d'un phare surmonte encore l'ensemble. Mais l'essentiel du rôle
de la tour était celui d'un symbole royal, à l'image des tours de
Philippe Auguste. La résidence des officiers royaux se trouvait
dans l'enceinte de la ville, sans fortification notoire.  La
conception de l'enceinte d'Aigues Mortes a certainement été dictée
par une urbanisation préexistante; les neuf portes qui s'y ouvrent
sont suffisamment proches et irrégulièrement disposées pour que
l'on puisse affirmer qu'elles desservirent des rues en usage, au
point que les tours à but exclusif de flanquement sont au nombre
de cinq seulement !
La
conception de l'enceinte d'Aigues Mortes a certainement été dictée
par une urbanisation préexistante; les neuf portes qui s'y ouvrent
sont suffisamment proches et irrégulièrement disposées pour que
l'on puisse affirmer qu'elles desservirent des rues en usage, au
point que les tours à but exclusif de flanquement sont au nombre
de cinq seulement !
