|
L'histoire du château
3 - Du XVIe au XVIIIe siècles
 Après
la période d'éclat remarquable qu'il avait connue
sous le règne du Roi René, le château de Tarascon
allait entrer dans une zone d'ombre. Après
la période d'éclat remarquable qu'il avait connue
sous le règne du Roi René, le château de Tarascon
allait entrer dans une zone d'ombre.
De toute évidence, le "verrou" de Tarascon avait
perdu son intérêt stratégique dès l'instant
où il avait été inclus dans le royaume de France,
royaume qui, grâce aux conquêtes et aux héritages
de Louis XI, avait approximativement sa configuration actuelle.
Par ailleurs, il faut souligner que, à peine fini, le système
de fortification du château était déjà
caduc. En effet, l'invention puis le perfectionnement de l'artillerie
avaient permis de venir à bout de ce genre de défense
dans un temps relativement bref. Il faudra attendre Vauban, inventeur
des glacis sur lesquels les boulets rebondissaient, pour retrouver
une architecture de défense militaire adaptée aux
armes nouvelles.
Petit à petit, le château, et donc la ville de Tarascon,
perdirent de leur lustre, ainsi qu'en témoigne la disparition
de l'atelier qui frappait monnaie dans le château grâce
au privilège accordé depuis 1272.
En 1565, au cours du voyage entrepris par Catherine de Médicis
à travers le pays pour présenter le jeune dauphin
Charles IX à ses sujets, la Reine et le futur Roi furent
accueillis par les Tarasconnais. Durant la période trouble
des guerres de religion, le château retrouva une certaine
importance stratégique, notamment lorsque Henri 111 nomma
gouverneur le général des Corses Alphonse d'Ornano,
pour faire front à l'agitation des Huguenots languedociens
qui cherchaient à occuper Beaucaire (1586). Alphonse d'Ornano,
fidèle à Henri III puis, par la suite, à Henri
de Bourbon, futur Henri IV, conserva le château de Tarascon
à la Couronne contre vents et marées.
Après le règne d'Henri IV, sous la régence
de Marie de Médicis, le Cardinal de Richelieu, revenant du
siège de Perpignan, s'arrêta à Tarascon du 12
juin au 17 août 1642 ; halte obligée, sa santé
s'étant gravement dégradée. Il élira
alors domicile à l'Hôtel du Rhuet situé à
proximité de la collégiale Sainte-Marthe et du château.
Si le Cardinal de Richelieu ne résida pas au château,
en revanche, Cinq-Mars et de Thou qui, après avoir tous deux
conspiré contre Richelieu avec la complicité de Gaston
d'Orléans, avaient été arrêtés
à Narbonne le 13 juin 1642, y furent incarcérés
sur le chemin du retour. Ils ne le quittèrent que pour aller
à Lyon où ils furent jugés, condamnés
à mort le 15 septembre 1642 et décapités le
même jour.
 Dès
cet instant, la forteresse va, plus ou moins, servir de prison militaire.
La Fronde, qui va déferler sur le royaume de France, n'épargnera
pas Tarascon. En 1652, le duc de Mercoeur, neveu de Mazarin, reprend
Tarascon de haute lutte après un siège de quatorze
jours. Dépourvu de rancune, le jeune Louis XIV, accompagné
de sa mère Anne d'Autriche et du Cardinal Mazarin, fait un
bref séjour à Tarascon en janvier 1660. Dès
cet instant, la forteresse va, plus ou moins, servir de prison militaire.
La Fronde, qui va déferler sur le royaume de France, n'épargnera
pas Tarascon. En 1652, le duc de Mercoeur, neveu de Mazarin, reprend
Tarascon de haute lutte après un siège de quatorze
jours. Dépourvu de rancune, le jeune Louis XIV, accompagné
de sa mère Anne d'Autriche et du Cardinal Mazarin, fait un
bref séjour à Tarascon en janvier 1660.
Dans la seconde partie du XVIIe siècle et pendant une grande
partie du XVIIIe siècle, le château servit uniquement
de prison militaire. Les prisonniers s'y succédèrent,
d'origine espagnole ou anglaise, selon les guerres. Les graffiti
laissés par les captifs sur les murs du château relaient
d'une façon très vivante leur présence dans
le bâtiment.
Quelques restaurations indispensables à la sauvegarde du
bâtiment furent exécutées vers 1720, 1736 et
1758.
Si la plupart des représentations héraldiques, ainsi
que les motifs décoratifs et les statues ornant le portail
de la chapelle basse de la cour d'honneur, furent détruits
au cours de la Révolution, le château était
déjà tellement détérioré intérieurement,
que les exactions de 1793 ne firent qu'achever une vandalisation
déjà avancée.
Page
précédente - Page
suivante |


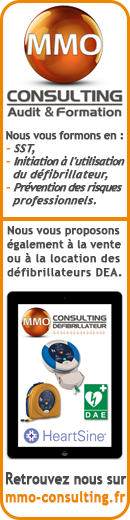
 Après
la période d'éclat remarquable qu'il avait connue
sous le règne du Roi René, le château de Tarascon
allait entrer dans une zone d'ombre.
Après
la période d'éclat remarquable qu'il avait connue
sous le règne du Roi René, le château de Tarascon
allait entrer dans une zone d'ombre. Dès
cet instant, la forteresse va, plus ou moins, servir de prison militaire.
La Fronde, qui va déferler sur le royaume de France, n'épargnera
pas Tarascon. En 1652, le duc de Mercoeur, neveu de Mazarin, reprend
Tarascon de haute lutte après un siège de quatorze
jours. Dépourvu de rancune, le jeune Louis XIV, accompagné
de sa mère Anne d'Autriche et du Cardinal Mazarin, fait un
bref séjour à Tarascon en janvier 1660.
Dès
cet instant, la forteresse va, plus ou moins, servir de prison militaire.
La Fronde, qui va déferler sur le royaume de France, n'épargnera
pas Tarascon. En 1652, le duc de Mercoeur, neveu de Mazarin, reprend
Tarascon de haute lutte après un siège de quatorze
jours. Dépourvu de rancune, le jeune Louis XIV, accompagné
de sa mère Anne d'Autriche et du Cardinal Mazarin, fait un
bref séjour à Tarascon en janvier 1660.
