|
L'histoire des Remparts
7 - La Ville
 Construite
d'après les plans établis par les ingénieurs du roi Louis IX, elle
était à peu près terminée lorsque saint Louis revint de sa première
croisade. La disposition de ses rues, parallèles et se coupant à
angles droits, l'emplacement de la place publique, aujourd'hui place
saint Louis, sont restés tels que lors de la construction. Rien
n'a été changé ni à l'alignement, ni à la largeur des rues. Mais
presque toutes les maisons ont été réédifiées ou restaurées. La
rue principale était la rue d'Artois qui partait de la porte du
même nom pour aboutir à la place publique. C'est aujourd'hui la
Grand Rue. Construite
d'après les plans établis par les ingénieurs du roi Louis IX, elle
était à peu près terminée lorsque saint Louis revint de sa première
croisade. La disposition de ses rues, parallèles et se coupant à
angles droits, l'emplacement de la place publique, aujourd'hui place
saint Louis, sont restés tels que lors de la construction. Rien
n'a été changé ni à l'alignement, ni à la largeur des rues. Mais
presque toutes les maisons ont été réédifiées ou restaurées. La
rue principale était la rue d'Artois qui partait de la porte du
même nom pour aboutir à la place publique. C'est aujourd'hui la
Grand Rue.
On peut regretter que, depuis moins d'un siècle, les divers propriétaires
n'aient pas respecté les délicats motifs qui ornaient la façade
de leurs immeubles. Les quelques sculptures de la Renaissance que
l'on peut encore admirer sur deux ou trois maisons, donnent une
faible idée de ce que devait représenter l'ensemble décoratif de
cette rue. Nous n'avons aux archives, et nous ne connaissons pas
ailleurs, aucun exemplaire du plan qui fut dressé pour la construction
de la ville au XIIIe siècle. Mais, par l'état des lieux, et les
divers et nombreux documents que nous avons consultés, nous pouvons
le reconstituer assez exactement.
La partie nord-ouest était le quartier militaire, avec la place
d'Armes, le château du Gouverneur communiquant avec la Tour de Constance.
La rue longeant le rempart se dirigeant sur la porte de Montpellier
et la Tour des Bourguignons, s'appelait la rue de la maison du Roi,
et devait comprendre les logements des officiers subalternes de
l'état-major. Sur la place publique, l'espace occupé par
la halle actuelle et les immeubles voisins, et qui s'étendait en
profondeur sur une centaine de mètres de la rue des Moulins à la
rue du Thieure, appartenait aux moines de Psalmodi. Les autres immeubles
delà place publique étaient occupés par des mangoniers et autres
marchands. Il existait également sur la place publique une halle
couverte qui a été démolie à la fin du XVIIIe siècle. La rue de
la Marine qui était la partie du boulevard Gambetta actuel, allant
de la rue Pasteur à la porte de la Marine, avait toutes ses maisons
du côté du Levant construites en arcades. Elles étaient occupées
par des administrations ou par des nobles et de hauts fonctionnaires.
Le quartier sud-est avait été réservé pour le couvent des Cordeliers
et la Poudrière; il était affecté à la population la plus pauvre
de la ville. Les maisons de ce quartier étaient si basses qu'un
homme pouvait toucher la toiture avec la main. Elles étaient bâties
sur un modèle uniforme, simple rez-de-chaussée, avec deux pièces
sans couloir, une donnant sur la rue servant de chambre à coucher
pour toute la famille. Ni plafond, ni plancher, ni carrelage, et
pas la moindre installation hygiénique. Il existe encore deux ou
trois spécimens de ces maisonnettes, servant de magasin, dans la
rue Emile-Jamais prolongée.
Au XIIIe siècle, et pendant la courte période de la grande activité
du port et de la prospérité relative de la ville, l'emplacement
compris entre les remparts était entièrement recouvert de maisons
d'habitation; sa population était d'environ 15000 âmes, d'après
M. Alexandre Esparron. Mais, dès que l'activité du port déclina,
ce déclin qui s'accentua jusqu'à la création du port de Sète, en
1866, consomma la ruine de celui d'Aigues-Mortes; la ville se dépeupla
peu à peu. Elle n'avait plus que 2.000 habitants en 1770.
De nombreux immeubles, non occupés, tombaient en ruines et, plutôt
que de faire des frais pour leur entretien, les propriétaires préféraient
les démolir. Il fallut une ordonnance de l'Intendant de la Province
en 1770, pour arrêter cette destruction. Au milieu du XVIIIe siècle,
existaient, et même jusqu'en 1875, nous nous souvenons avoir vu,
à l'intérieur des remparts, de grands espaces vacants, dont certains,
entourés de fossés à l'eau croupissante, étaient livrés à la culture.
Plus d'un quart de la surface intérieure de la ville était non-bâtie.
Mais, à partir de cette époque tous ces vacants ont été lotis, et
aussitôt recouverts de constructions à usage d'habitation ou de
magasins à vin.
Extrait d'un texte
du Centre des Monuments Historiques
|


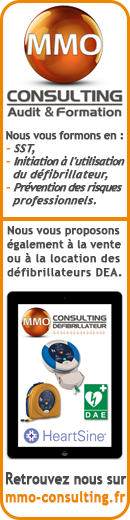
 Construite
d'après les plans établis par les ingénieurs du roi Louis IX, elle
était à peu près terminée lorsque saint Louis revint de sa première
croisade. La disposition de ses rues, parallèles et se coupant à
angles droits, l'emplacement de la place publique, aujourd'hui place
saint Louis, sont restés tels que lors de la construction. Rien
n'a été changé ni à l'alignement, ni à la largeur des rues. Mais
presque toutes les maisons ont été réédifiées ou restaurées. La
rue principale était la rue d'Artois qui partait de la porte du
même nom pour aboutir à la place publique. C'est aujourd'hui la
Grand Rue.
Construite
d'après les plans établis par les ingénieurs du roi Louis IX, elle
était à peu près terminée lorsque saint Louis revint de sa première
croisade. La disposition de ses rues, parallèles et se coupant à
angles droits, l'emplacement de la place publique, aujourd'hui place
saint Louis, sont restés tels que lors de la construction. Rien
n'a été changé ni à l'alignement, ni à la largeur des rues. Mais
presque toutes les maisons ont été réédifiées ou restaurées. La
rue principale était la rue d'Artois qui partait de la porte du
même nom pour aboutir à la place publique. C'est aujourd'hui la
Grand Rue.
