|
COUPABLE DE CROISADE
La croisade contre
les albigeois 1208 - 1243
14a - L'intégration
Depuis le traité de
Paris, les pays du midi étaient désormais sous la coupe du roi de
France : directement, pour les fiefs de Simon de Montfort, après
le renoncement d'Amaury, son fils, indirectement, pour le comté de
Toulouse, avec le titre retrouvé de Raimond VII. Mais le traité
de Paris est un contrat inique qui refuse aux descendants de Raimond
VII la légitimité du titre. Seule la fille de Raimond, Jeanne, mariée
à Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, et enlevée de force à
sa mère pour être emmenée à Paris auprès de la régente Blanche de
Castille, est l'héritière du titre et des fiefs. Tout autre descendant
direct, même officiel, de Raimond VII ne sera pas reconnu. De plus,
si la princesse ne procrée pas, le comté de Toulouse sera automatiquement
intégré au domaine royal. Raimond VII, tenu par ce traité qui lui
a été exigé quasiment de force, essaiera de renverser la situation,
notamment en s'alliant au comte de la Marche, Hugues de Lusignan,
à qui il avait essayé auparavant de marier Jeanne. Le comte de la
Marche est le meneur de la ligue des seigneurs qui vont essayer
de lutter contre le pouvoir royal grandissant en se rebellant contre
la régente. Mais ce mouvement n'aura pas de suite, et Raimond sera
forcé de rentrer dans le rang. En 1249, Raimond VII meurt, la princesse
Jeanne hérite mais c'est son mari Alphonse de Poitiers, frère du
roi, qui devient comte de Toulouse. Il viendra à Toulouse seulement
deux fois avant sa mort en 1270. De retour de la VIII° croisade
au cours de laquelle Louis IX mourra devant Tunis, Alphonse de Poitiers,
meurt à son retour en France ; sa femme Jeanne, qui l'avait accompagné
en Croisade, meurt un jour plus tard. Selon les termes du traité,
le comté de Toulouse est intégré au domaine royal. C'est la fin
définitive du comté de Toulouse en tant que territoire autonome
et indépendant.
renoncement d'Amaury, son fils, indirectement, pour le comté de
Toulouse, avec le titre retrouvé de Raimond VII. Mais le traité
de Paris est un contrat inique qui refuse aux descendants de Raimond
VII la légitimité du titre. Seule la fille de Raimond, Jeanne, mariée
à Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, et enlevée de force à
sa mère pour être emmenée à Paris auprès de la régente Blanche de
Castille, est l'héritière du titre et des fiefs. Tout autre descendant
direct, même officiel, de Raimond VII ne sera pas reconnu. De plus,
si la princesse ne procrée pas, le comté de Toulouse sera automatiquement
intégré au domaine royal. Raimond VII, tenu par ce traité qui lui
a été exigé quasiment de force, essaiera de renverser la situation,
notamment en s'alliant au comte de la Marche, Hugues de Lusignan,
à qui il avait essayé auparavant de marier Jeanne. Le comte de la
Marche est le meneur de la ligue des seigneurs qui vont essayer
de lutter contre le pouvoir royal grandissant en se rebellant contre
la régente. Mais ce mouvement n'aura pas de suite, et Raimond sera
forcé de rentrer dans le rang. En 1249, Raimond VII meurt, la princesse
Jeanne hérite mais c'est son mari Alphonse de Poitiers, frère du
roi, qui devient comte de Toulouse. Il viendra à Toulouse seulement
deux fois avant sa mort en 1270. De retour de la VIII° croisade
au cours de laquelle Louis IX mourra devant Tunis, Alphonse de Poitiers,
meurt à son retour en France ; sa femme Jeanne, qui l'avait accompagné
en Croisade, meurt un jour plus tard. Selon les termes du traité,
le comté de Toulouse est intégré au domaine royal. C'est la fin
définitive du comté de Toulouse en tant que territoire autonome
et indépendant.
14b - Les coupables
Le Languedoc a été
dévasté pendant près de cinquante ans, il a perdu son indépendance
et une partie de sa culture et sa population a été décimée. Il remettra
des dizaines d'années pour se relever économiquement mais contestera
chaque fois qu'il le pourra le pouvoir central français. Qui sont
donc les responsables et les coupables ? Bien sûr, les languedociens
avaient embrassé une religion hérétique qui ne rentrait pas dans
la normalité du temps. Les seigneurs du midi ont protégé systématiquement
leurs sujets sans s'inquiéter de leurs croyances. C'était peut-être
de l'inconscience de leur part, mais peut-être était-ce plutôt de
l'inquiétude face aux menaces sous-jacentes exprimées par l'Eglise.
Le catharisme est une explication des besoins spirituels des languedociens,
mais certainement pas une menace directe pour la société occitane.
Ca l'a été par contre pour l'Eglise catholique, ou plus exactement
pour le Pape, gardien de l'intégrité et de l'orthodoxie de la Chrétienté.
Il est normal que le pape ait voulu lutter contre l'hérésie, et
nous l'avons vu, il a épuisé tous les moyens de redresser la situation.
Sa responsabilité dans le lancement de la croisade est revendiquée
et affirmée, mais sa faute fut alors de confier la croisade à des
personnages qui l'ont utilisée à des fins purement personnelles
et surtout intéressées. En fait, c'est bien les personnages-clefs
qui ont fait de la croisade ce qu'elle est devenue par la suite,
et non les idées développées d'un coté par l'Eglise et de l'autre
par les cathares. Les légats et les évêques du Languedoc et au premier
plan, Arnaud-Amaury et Foulques, évêque de Toulouse, sont directement
responsables de la croisade, de ses agissements et de ses égarements.
Ils sont coupables d'avoir abusé des pouvoirs qui leur avaient été
accordés par le pape ; ils sont coupables d'avoir imposé leur vision
personnelle de la lutte contre l'hérésie, et surtout contre les
seigneurs occitans. Ils sont aussi coupable d'en avoir profité pour
s'imposer comme un pouvoir politique incontournable et quelque fois
usurpateur. Ils ont été les maîtres réels de la croisade en étant
son guide moral, et en bénissant les massacres perpétrés par Simon
de Montfort. Ce dernier, quant à lui, n'a été que l'exécuteur des
basses-oeuvres en essayant de profiter de la situation pour se tailler
un domaine le plus grand possible. Ceci ne lui fut pas reproché,
au contraire. Car le but principal de la croisade n'a pas été l'éradication
de l'hérésie cathare, mais bien la conquête de territoires et le
remplacement d'une noblesse locale par celle qui conduisait la croisade.
Simon de Montfort, avec la bénédiction des légats et des évêques,
a détruit la dynastie des Trencavel, et luttera jusqu'au bout contre
celle de Saint-Gilles. La lutte contre l'hérésie n'a donné lieu
qu'à un massacre systématique mais qui aurait eu lieu même si les
seigneurs occitans avaient lutté au coté de l'Eglise ; l'apparition
de l'Inquisition est un épiphénomène de la croisade et constitue
une histoire presque séparée.
Pourtant, si les coupables principaux sont bien les meneurs de la
croisade, en paroles et en actes, il en est un qui profita en permanence
de la situation et tira à la fin, comme le dit la fable, les marrons
du feu : c'est la royauté française. Philippe-Auguste a joué en
permanence : avec les barons français, pour les envoyer à la bataille
conquérir une nouvelle province, avec Simon de Montfort, qu'il reconnu
comme vassal tout en sachant qu'il n'aurait jamais les moyens de
se maintenir et qu'il lui faudrait forcément faire appel à lui,
avec le Pape en exigeant des compensations disproportionnées pour
accepter son engagement par l'intermédiaire du prince Louis. Ses
successeurs continueront la même politique : Louis VIII négociera
avec le pape pour obtenir les titres de Aymeri de Montfort avant
la deuxième croisade, Blanche de Castille conquerra le Languedoc,
prenant dans ses rets Raimond VII en kidnappant sa fille la princesse
Jeanne. On peut dire de manière sûre que si le Languedoc n'avait
jamais intéressé le roi de France, il serait resté indépendant,
et l'Eglise aurait reconnu les droits de Raimond VII. La croisade
contre les Albigeois peut donc presque se résumer en une guerre
de colonisation du midi par le roi de France. Encore une fois, l'hérésie
ne fût qu'une parenthèse. Tôt ou tard, l'Eglise aurait trouvé un
moyen d'éliminer cet abcès, et il faudra de toute façon attendre
l'arrivée de pouvoirs réellement indépendants de l'Eglise, pour
voir une religion différente du catholicisme avoir un caractère
officiel.
Texte de Philippe
BEZARD-FALGAS (1997)
Retrouvez plus d'information
sur l'histoire Cathare sur le site www.cathares.org
|

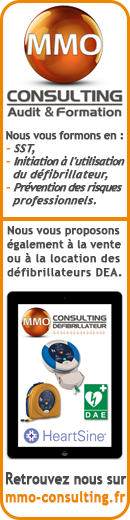
 renoncement d'Amaury, son fils, indirectement, pour le comté de
Toulouse, avec le titre retrouvé de Raimond VII. Mais le traité
de Paris est un contrat inique qui refuse aux descendants de Raimond
VII la légitimité du titre. Seule la fille de Raimond, Jeanne, mariée
à Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, et enlevée de force à
sa mère pour être emmenée à Paris auprès de la régente Blanche de
Castille, est l'héritière du titre et des fiefs. Tout autre descendant
direct, même officiel, de Raimond VII ne sera pas reconnu. De plus,
si la princesse ne procrée pas, le comté de Toulouse sera automatiquement
intégré au domaine royal. Raimond VII, tenu par ce traité qui lui
a été exigé quasiment de force, essaiera de renverser la situation,
notamment en s'alliant au comte de la Marche, Hugues de Lusignan,
à qui il avait essayé auparavant de marier Jeanne. Le comte de la
Marche est le meneur de la ligue des seigneurs qui vont essayer
de lutter contre le pouvoir royal grandissant en se rebellant contre
la régente. Mais ce mouvement n'aura pas de suite, et Raimond sera
forcé de rentrer dans le rang. En 1249, Raimond VII meurt, la princesse
Jeanne hérite mais c'est son mari Alphonse de Poitiers, frère du
roi, qui devient comte de Toulouse. Il viendra à Toulouse seulement
deux fois avant sa mort en 1270. De retour de la VIII° croisade
au cours de laquelle Louis IX mourra devant Tunis, Alphonse de Poitiers,
meurt à son retour en France ; sa femme Jeanne, qui l'avait accompagné
en Croisade, meurt un jour plus tard. Selon les termes du traité,
le comté de Toulouse est intégré au domaine royal. C'est la fin
définitive du comté de Toulouse en tant que territoire autonome
et indépendant.
renoncement d'Amaury, son fils, indirectement, pour le comté de
Toulouse, avec le titre retrouvé de Raimond VII. Mais le traité
de Paris est un contrat inique qui refuse aux descendants de Raimond
VII la légitimité du titre. Seule la fille de Raimond, Jeanne, mariée
à Alphonse de Poitiers, frère de Louis IX, et enlevée de force à
sa mère pour être emmenée à Paris auprès de la régente Blanche de
Castille, est l'héritière du titre et des fiefs. Tout autre descendant
direct, même officiel, de Raimond VII ne sera pas reconnu. De plus,
si la princesse ne procrée pas, le comté de Toulouse sera automatiquement
intégré au domaine royal. Raimond VII, tenu par ce traité qui lui
a été exigé quasiment de force, essaiera de renverser la situation,
notamment en s'alliant au comte de la Marche, Hugues de Lusignan,
à qui il avait essayé auparavant de marier Jeanne. Le comte de la
Marche est le meneur de la ligue des seigneurs qui vont essayer
de lutter contre le pouvoir royal grandissant en se rebellant contre
la régente. Mais ce mouvement n'aura pas de suite, et Raimond sera
forcé de rentrer dans le rang. En 1249, Raimond VII meurt, la princesse
Jeanne hérite mais c'est son mari Alphonse de Poitiers, frère du
roi, qui devient comte de Toulouse. Il viendra à Toulouse seulement
deux fois avant sa mort en 1270. De retour de la VIII° croisade
au cours de laquelle Louis IX mourra devant Tunis, Alphonse de Poitiers,
meurt à son retour en France ; sa femme Jeanne, qui l'avait accompagné
en Croisade, meurt un jour plus tard. Selon les termes du traité,
le comté de Toulouse est intégré au domaine royal. C'est la fin
définitive du comté de Toulouse en tant que territoire autonome
et indépendant.
